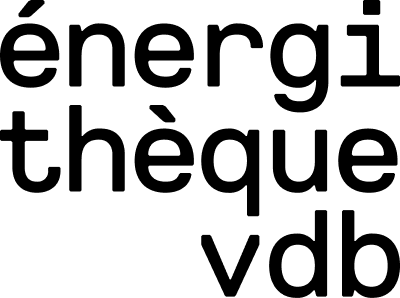La sobriété énergétique dans les territoires de montagne
Lors de la dernière conférence "SWEET Lantern", un consortium visant à faire émerger des solutions pour que la Suisse atteigne la neutralité carbone en 2050, l'Energithèque a été invitée pour présenter les enjeux de la sobriété énergétique dans les territoires de montagne. Une idée forte y était soutenue: l'urgence de redonner toute sa place à la sobriété énergétique, comme levier collectif de la transition, en particulier dans les villes alpines.
Dans les Alpes suisses, les températures augmentent deux fois plus vite que la moyenne mondiale, avec des impacts importants sur les glaciers, l’enneigement et les écosystèmes de haute altitude. De plus, ces territoires sont fortement dépendants du froid, notamment pour les activités économiques liées au tourisme hivernal, ce qui accentue leur vulnérabilité. Par ailleurs, le changement climatique entraîne une augmentation des risques naturels, tels que les éboulements, les crues ou les glissements de terrain, qui affectent directement les infrastructures. Enfin, l’évolution du régime des précipitations et de la fonte des glaciers affecte la disponibilité en eau, ce qui génère des tensions entre les différents usages : tourisme, agriculture, hydroélectricité, biodiversité.
Généralement, lorsqu’on parle de politique énergétique, on mentionne le plus souvent les deux leviers qui sont les plus aisés à mettre en œuvre : l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ces deux leviers sont nécessaires et sont bien évidemment des incontournables dans nos stratégies énergétiques. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés qui glorifient la technique mais, la transition énergétique n’est pas qu’une simple transition technique. La transition énergétique nous invite à nous poser collectivement plusieurs questions sur notre rapport à l’énergie : quels besoins peuvent être remis en cause ? Quels usages et valeurs peut-on faire évoluer ?
La traduction anglaise du terme est très appropriée, « sufficiency », consommer en suffisance, consommer juste ce dont on a besoin. La sobriété n’est pas le moindre des leviers, elle a un rôle clé et reste pourtant si mal connue ou mal perçue. C’est le levier de la transition énergétique qui soulève le plus de réaction, car la sobriété réinterroge les fondements mêmes de notre modèle de société, elle invite à réduire, à réutiliser et à recycler, des concepts à contre-courant de nos modèles économiques actuels.
La sobriété porte en elle une interrogation profonde sur l’impact et le fonctionnement de nos systèmes technico-économiques, tel que la société de consommation au sens large et les modes de consommation individuels et leurs impacts matériels et énergétiques.
Le premier niveau d'application de la sobriété est celui de nos choix individuels. Les comportements de consommation comptent, incontestablement. Si tout le monde avait un comportement parfaitement vertueux dans les domaines de la mobilité, du logement et de l’alimentation qui présentent les plus grands gisements d’économie , on parle d’un quart de réduction des consommation d'énergie à 2050 selon le scénario Négawatt. C’est beaucoup, mais c’est loin de suffire.
Le deuxième niveau est celui de la sobriété systémique. C’est le plus important. Il est difficile de demander de la sobriété individuelle dans une société organisée autour de l’abondance et du gaspillage. En effet, chaque individu subit les contraintes des réalités matérielles en matière d'aménagements du territoire, de technologies existantes et de bien et de services disponibles. Il est illusoire d'attendre des individus qu'ils renoncent unilatéralement à l'achat de certains biens alors qu'ils sont toujours légaux et disponibles.
Par exemple, pour faire du vélo, il faut des pistes cyclables, et pour que le vélo devienne un moyen de déplacement majeur, il faut que la répartition spatiale de l’emploi, de l’habitat, des services, ne soit pas trop éclatée. Ou si l’on veut limiter l’impact désastreux de la fast fashion ou de l’obsolescence programmée, il faut un cadre légal pour limiter ou interdire l’importation de ces produits ou régir leur fabrication.
Il existe quatre types de sobriété:
- La sobriété d’usage : il s’agit du comportement que l’on adopte dans l’usage d’un objet ou d’une technologie, par exemple la fréquence et la durée d’utilisation, les fonctionnalités que l’on décide de sélectionner ou non…
- La sobriété collaborative : La sobriété est conviviale, permet de créer des liens au travers du partage et de la coopération. Il s’agit, tout en recréant du lien entre les personnes, de pratiquer une activité permettant de faire des économies d’énergie et de ressources naturelles. C’est le cas des Repair Cafés (ateliers participatifs de réparation d’objets) ou des accorderies (échange de savoir-faire et de connaissances).
- La sobriété dimensionnelle : il s’agit de veiller à ce que la taille et le poids des objets que l’on utilise ne soient pas surdimensionnées par rapport à l’usage qui en est fait.
- La sobriété structurelle et organisationnelle : il s’agit de la façon dont l’aménagement du territoire structure l’espace, influence l’organisation du territoire et des modes de vie. il s’agit de repenser nos modes d’organisation collective afin d’adopter de nouvelles façons de se déplacer, de travailler, d’habiter, de consommer.
Pour pérenniser la sobriété au-delà du court terme et l’intégrer comme un levier structurel au service d’une transition juste et ambitieuse, il est crucial que les organisations, structures et personnes détentrices d'un pouvoir de décision en fassent un axe structurant de leurs politiques énergétiques et implante la sobriété dans tous les domaines, à tous les niveaux de décision et dans toute les politiques. Cela doit se traduire par des politiques publiques concrètes et ambitieuses favorisant l’adoption durable de pratiques moins énergivores et freinant les comportements les plus consommateurs.
Ces politiques publiques devront s’accompagner d’un important effort de communication, de sensibilisation et de pédagogie. Celui-ci devra s’appuyer sur un récit positif et mobilisateur, mettant en valeur les co-bénéfices de la sobriété en matière de santé, de cohésion sociale et de recul des inégalités.